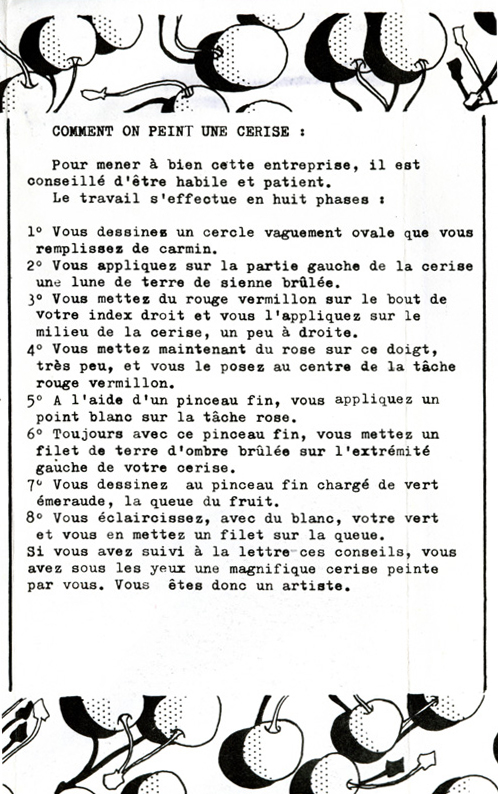Palissade, 1975.
La cerise est apparue très tôt dans l’œuvre de Jacques Halbert, en 1975, de la façon la plus incongrue qui soit, tatouant de façon répétée une palissade de chantier peinte en bleu azur. Une cerise par planche, toutes bien alignées. Les planches sont irrégulières, mais j’aime à imaginer que celles-ci avaient une largeur unique; de 8,7 cm, par exemple, cette mesure désormais très conceptuelle. Très vite, la cerise investit la toile sur châssis et y trouve sa juste mesure. Un an plus tard, Jacques Halbert peint les lettres du mot «plaisir » (1975) en rondes de cerises rouges ; il persiste et fait de même avec le mot «fraise » (1975). René Magritte n’aurait pas désavoué cette déclinaison de « la Trahison des images », cette mise en jeu de l’énoncé, de l’objet, de l’image et de l’objet nommé. La délectation habite la cerise vermillonne et « la gourmandise emporte l’adhésion, écrira Pierre Giquel, nous sommes en région comestible, la fête bat son plein ». En 1978, l’artiste confirme cette idée saugrenue qui fait office de manifeste d’une véritable folie, d’une extrava- gance, d’un goût exclusif – car l’œuvre est de bon goût -, et d’une gaîté vive : «peindre des cerises partout, tout le temps, et ne penser qu’à ça ». Ne penser qu’à ça : à prononcer ces mots, il y a déjà là quelque chose de profondément jouissif. Et comme un parfum d’obsession au sens où l’entendait Harald Szeemann, lui qui se préoccupait, entre autres choses, des circuits fermés et des machines célibataires, de la coercition par la beauté et des édifices bâtis par les Illuminés. L’obsession, écrit Szeemann, est « une unité d’énergie joyeusement reconnue ». Pour Jacques Halbert, celle-ci a une forme vaguement ovale de couleur carmine et vermillonne, prolongée sur sa gauche par un filet vert émeraude. Oui, la queue de cerise a aussi toute son importance. (…)
(…) Scandaleuse liberté, digne héritière de l’exhubérance Dada, tendance Picabia. Et révolte supérieure de l’esprit. Celle- ci sied à Jacques Halbert qui, rappelons le, se permit un jour en guise d’appropriation et d’hommage, d’apposer – sans dommage – l’une de ses cerises sur un Picabia du musée. Comment, ici, ne pas rappeler le « Manifeste cannibal », la scansion de « Dada n’est rien. Comme vos paradis : rien ». « Y’a bon Picabia ! » bonimente, avec le rire de Jacques Halbert, le tirailleur sénégalais de Banania, peint sur le coffre de la Peugeot 403, version 1962, couverte de cerises, customisée dira-t-on, et aujourd’hui garée au beau milieu de l’atelier. Oui l’empreinte de la cerise, au sens toronien du terme, s’applique partout. Sur des boîtes de camembert, des affiches Mao, des bons points distribués aux enfants méritants, des reproductions de tableaux de maîtres anciens et modernes, des peintures trouvées. Elle contamine tout support et surtout se peint sur toile, cerise toujours dupliquée, jamais épuisée. Rarement solitaires, au moins par paires, souvent alignées, en quadrilles, essaimées, constellantes, les fruits sont à maturité. Il y a des « Cerises bleues sur fond bleu », des « Cerises blanches sur fond blanc », des « Cerises vertes sur fond vert », des « Cerises jaunes sur fond jaunes » et, on s’en doute, des «Cerises rouges sur fond rouges ». Le sujet résiste au fil de ces inlassables répétitions d’une même cerise.
J’aime le protocole que Jacques Halbert établit dès 1975. Il tient de la méthode ABC Ecole de Paris (« comment peindre une cerise en huit phases et temps de séchage »), de la recette de cuisine, se teinte d’esprit Fluxus et remet dès lors en question avec impertinence l’absolutisme des positions minimalistes et conceptuelles en vogue à l’époque, qu’il s’agisse, dans le paysage français du moins, du dogmatisme de Support / Surface ou du radicalisme des positions de B.M.P.T.
Avec la vivifiance du chant du merle moqueur, l’obsessionnelle aventure cerisiste élargira ses horizons : Jacques Halbert se revendique d’un art d’attitude, au sens où l’entend Ben Vautier, entretenant des rapports étroits avec les arts de la table, lorgnant du côté de l’ « Eat Art » de Spoerri, rien d’austère assurément ; parce qu’il est vital d’arpenter les lieux de l’art avec un triporteur transformé en « galerie Cerise », afin de vendre, comme à la criée, tartelettes et tableaux aux cerises, important de chanter des recettes ou de déclamer un menu cerise devant les Noces de Cana de Véronèse, essentiel de naviguer sur la Loire toute toile aux cerises dehors, excitant d’organiser des Fashion Show cerisistes à New York ou de se prendre pour un pâtissier pâ- tissé, inattendu d’offrir un « dix nez » aux cerises à toute une kyrielle de convives ou de se commettre dans des séances de peinture au marteau. (…)
Le motif, ce qui fait l’objet d’une répétition de forme bien définie, régulière et continue, est ici ce qui catalyse une obsession, un univers, une façon de percevoir le monde et de le vivre. Dans le cas de Jacques Halbert, la cerise passe de l’état inerte à l’état vivant : « La matière qui l’a formulée, écrit Frédéric Bouglé, se fixe dans le geste de peindre entre agrégation et dissolution du sujet, entre sexualité suggérée et sensualité affirmée, entre culture culinaire, culture populaire et culture savante, entre, enfin, la joie prégnante d’un présent exalté et les temps jamais oubliés d’une cueillette passée » (…)
Jean-Michel Botquin, dans Le Paradis perdure, 2013
Camouflage, 2018, 80 x 80 cm
The Cherry Kitchen, 2014. Galerie Nadja Vilenne
[sociallinkz]