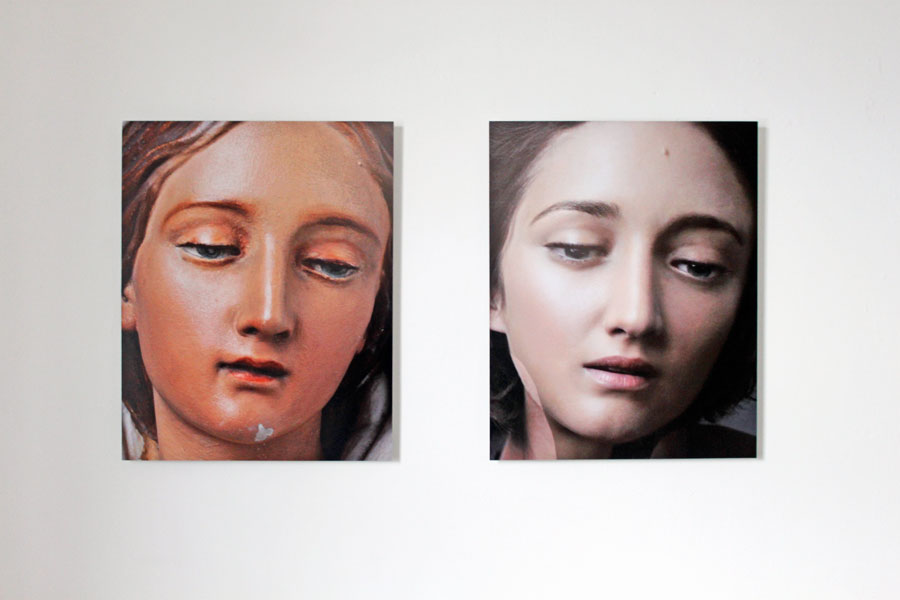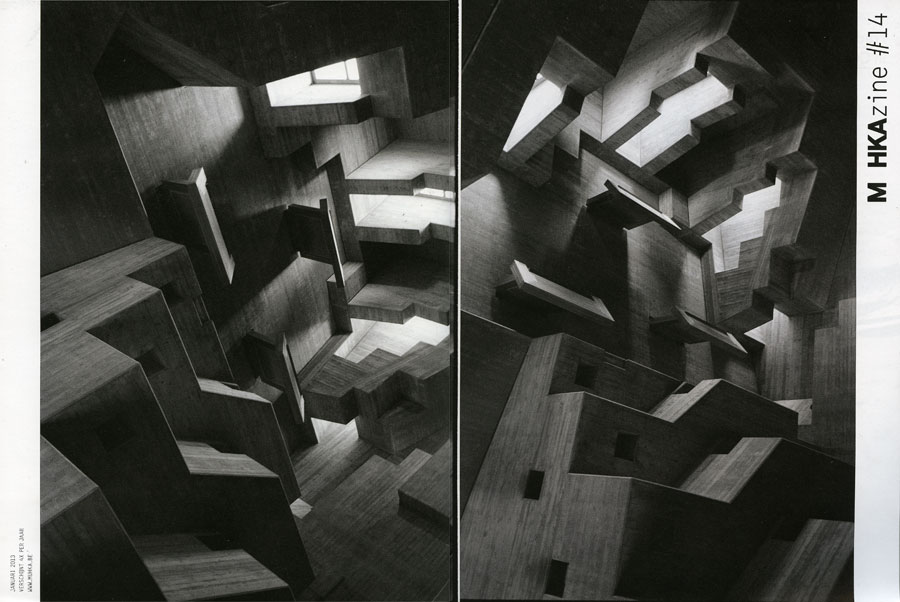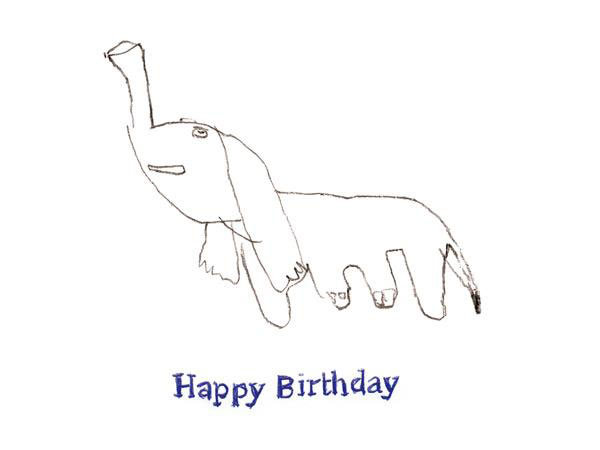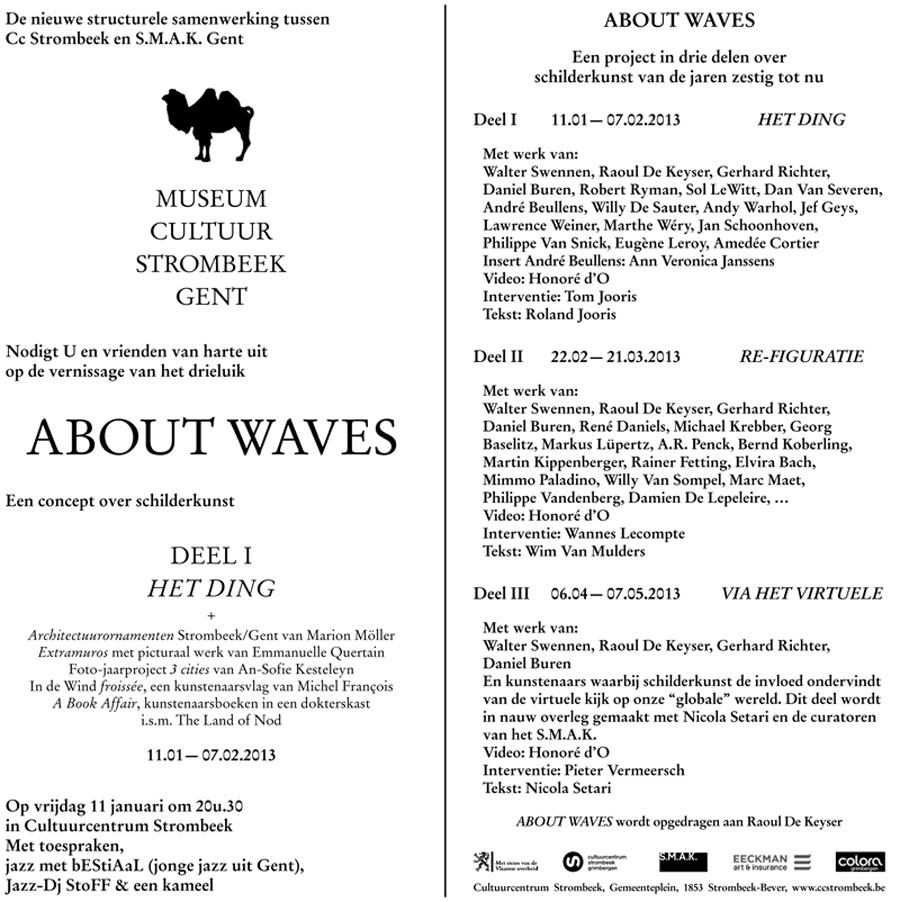De Pol Pierart, on connaît bien sûr la peinture, des acryliques sur toiles libres, parfois aussi grandes qu’un calicot, ses travaux sur papier, ses photographies au format d’une carte postale, un médium qu’il décline dans la simplicité et l’immédiateté du noir et blanc. A ces pratiques, depuis le début des années 2000, Pol Pierart a ajouté celle du film. Il en existe aujourd’hui une trentaine. Paraphrasant Paul Nougé, dont on sait que l’œuvre est d’une importance capitale pour tout saboteur du langage, je serais tenté d’écrire qu’ainsi « L’Expérience continue »1, tant cette production filmique s’inscrit dans une pure continuité du travail, qu’il s’agisse d’envisager celui-ci sur le plan de sa finalité ou de considérer les moyens mis en œuvre. Ceux-ci sont, on le sait, des plus simples et économes.
Pol Pierart publie aujourd’hui un cinquième recueil de photographies2. Le livre est au format des œuvres ; dans son argumentaire, comme pour les quatre précédents ouvrages d’ailleurs, son éditeur qualifie ces photographies de calembourgeoises. Pol Pierart précise, il est vrai et non sans malice, qu’il n’a d’autre revendication au travers de ses créations que celle de tout un chacun : changer le monde ! « La prétention ridicule de ce dessein, ajoute-t-il, ne vous échappera pas, mais ce qui importe réellement, c’est d’aller constamment dans ce sens ». Pas question dès lors que je cale en bourgeois, le calembour est évidemment tentant.
J’ai lu, un jour, que les photos de Pol Pierart étaient « trompeuses et drôles, affichant leurs faux airs de natures mortes et leurs vraies bizarreries »3. Drôles, pas toujours, drôlement lucides, certainement. Le titre de ce cinquième opus est d’ailleurs révélateur : « Angoisse ça te regarde ? ». Très singulières, ces photographies le sont tout autant. Ce sont, la plupart du temps, de petites mises en scène, appariant des mots et des objets. Des cartons, des écriteaux, parfois des inscriptions interagissent avec les objets posés dans le champ, voire, lorsque l’artiste quitte l’atelier, avec le paysage urbain ; ils donnent à lire de courtes phrases qui fonctionnent comme des énoncés aphoristiques, des petites sentences péremptoires ; ces courtes phrases résonnent comme des slogans, des lieux communs, des phrases de routine, des truismes proverbiaux ou des annonces publicitaires. Pol Pierart substitue une lettre, un phonème pour un autre, il remplace un mot par un autre qui lui est proche, phonétiquement ou sémantiquement. Il bouscule les isotopies, il cherche une efficacité toute perlocutoire, il détourne et modifie le sens ; plus simplement, il considère le langage comme une pâte à modeler, en toute irrégularité.
Bon nombre de ces courtes affirmations sont en effet des calembours, ces jeux de mots fondés sur une similitude de sons recouvrant une différence de sens. Je repense aux aphorismes de Paul Nougé. « On sait ce que parler veut rire ». « A l’humour à la mort ». « Le jeu des mots et du hasard ». « Il faut penser à travers tout ».
Paul Nougé, en effet, n’est assurément pas loin. Je retrouve dans ses « Notes sur la poésie »4, publiées dans « Les Lèvres Nues », ce passage sur le langage. Les œuvres de Pol Pierart m’en semblent, en effet, fort proches : « Le langage, estime Nougé, et particulièrement le langage écrit (est) tenu pour un objet, un objet agissant sans doute, c’est à dire capable à tout instant de faire sens, mais un objet détaché de qui en use au point qu’il devient possible dans certaines conditions de le traiter comme un objet matériel, une matière à modifications, à expérience. D’où l’intérêt, tout particulier des jeux qui ont pour élément principal le langage : jeux de mots, devinettes, charades, papiers pliés ; l’intérêt des démarches qui tendent à situer le langage en tant qu’objet, à l’analyser : grammaire, syntaxe, sémantique ; l’intérêt de ses manifestations naïves les plus détachées que puisse admettre le commun des esprits : réclames, anecdotes, fables, apologues ; ou pour mieux dire, là où le commun des esprits en use avec le plus de liberté, avec le seul souci, indépendamment de toute préoccupation d’expression ou de véracité, d’un effet à produire ». Oui, dans l’œuvre de Pol Pierart, le langage est un objet modifiable à la manière d’un objet matériel, un objet très concret, un carton, un écriteau, que Pol Pierart met d’ailleurs en relation avec d’autres objets matériels, un ours en peluche, un petit squelette, un crucifix, des espadrilles, une main, des clous, une mappemonde, un gant, une commode, un miroir, des objets courants et sans prestige, l’effet produit, créateur de sens, n’étant d’ailleurs pas sans conséquences.
Les mises en scènes sont simples et directes, percutantes. Tout appartient au quotidien du langage et de la vie. Très peu de choses suffisent à donner du sens, à évoquer une réflexion. Je retrouve là, encore une fois, l’esprit du poète surréaliste qui conseille en effet de « prendre les éléments de la création aussi près que possible de l’objet à créer, jusqu’à tendre à cette situation idéale où la chose souhaitée naîtrait, par l’introduction d’une seule virgule, d’une page d‘écriture ; d’un tableau de complexe peinture, par le jeu d’un seul trait d’encre noire »5. Escamoter une lettre dans un mot suffit parfois à changer le sens. Ou même une partie de lettre. « Je me sens bien », écrit en majuscules, se transforme en « je me sens rien » dès le moment où Pol Pierart pose simplement le doigt sur la base du tracé de la lettre B. Un doigt, qu’il se permet d’ailleurs d’écrire « je doigt » dès que celui-ci se fait injonctif. Lorsqu’un petit tank, un jouet, écrase un petit squelette, l’expression « en chair et en os » devient « en char et en os ». Un inquiétant gant de cuir noir posé comme un rapace sur une mappemonde évoque « la loi du plus fort / la loi du plus mort ». Certaines de ces images fonctionnent comme de véritables Vanités, d’autres évoquent la difficulté d’être, l’inconvénient d’être né, l’inéluctabilité de la mort. « Un pied devant l’autre, les deux pieds devant ». Un ours en peluche et un squelette brandissent deux pancartes : « le passé c’est mort », constate l’un, « L’avenir c’est la mort » annonce l’autre. « Bienvenue en enfer » ; ce dernier carton dissimule mal au regard une poussette d’enfant. Décidément, nous sommes « Primé / périmé », c’est écrit dans les lignes de la main.
Pol Pierart pointe toutes nos angoisses existentielles, il épingle nos contradictions. « Exceptez-moi comme je suis ». Ses satires portent sur l’hypocrisie ou l’égarement religieux : « A quoi bon des béquilles, si c’est pour se casser la gueule de toute façon », « Prions – prisons » ; il souligne les cruautés planétaires également, les injustices sociales, – « Home street home » -, ou la simple difficulté d’être ensemble : « haine – humaine » ; « tout seul, on est rien, ensemble on est trop ». Ainsi passe-il du registre le plus trivial, – « Même la pluie tombe de travers » -, au registre le plus grave : « tout baigne – dans le sang ».
« Si le propre du calembour est d’être employé à des fins purement ludiques, les jeux de mots de Nougé témoignent eux d’intentions graves, écrit Geneviève Michel6. En effet, le lien qui s’établit entre l’émetteur et le destinataire du jeu de mots nougéen est censé être celui de l’éveilleur à l’éveillé : la légère distorsion éveille l’attention, la curiosité, l’intérêt du lecteur ; et le décalage de sens est sensé conduire le lecteur attentif, réceptif, à une réflexion, à une remise en question, à un enrichissement de l’esprit ». Sans aucun doute est-ce là l’esprit qui anime également Pol Pierart, pour qui la création n’est jamais une fin en soi, mais bien une « adresse » au spectateur. Le format carte postale des tirages barytés s’inscrit dans cette optique. Leur encadrement de bois noir, serré sur l’image également : il s’agit de « faire part », dans toutes les acceptions du terme.
Pol Pierart s’est toujours revendiqué des phylactères de son enfance. Les grandes grèves de la sidérurgie liégeoise l’ont également marqué : revendications, calicots, panneaux et écriteaux ont influé son imaginaire. Il y a une similitude entre le slogan, qu’il soit publicitaire, social ou politique, et l’énoncé poétique, en ce sens qu’ils utilisent les mêmes ressources de la langue, bien que leur fin pragmatiques soient différentes. Paul Nougé, encore lui, l’avait bien compris ; l’expérience de la « publicité transfigurée » est à ce sujet exemplaire. En 1927, Nougé promène dans les rues de Bruxelles un placard géant sur lequel il est écrit : « Ce boulevard encombré de morts. Regardez vous y êtes »7. Valeur d’usage et valeur d’échange se parasitent, tout comme sphère privée, celle de la littérature, et sphère publique, lieu d’une tentative de socialisation de l’art. L’apostrophe se veut directe ; l’indifférence que suscita cette performance atteste que l’efficacité de l’art est plus facile à concevoir qu’à démontrer en pratique.
A cette pratique photographique, Pol Pierart a donc ajouté celle du film. Le médium est évidemment tentant. Il a ses qualités ontologiques, celle d’être, par rapport à la photographie, une succession de photogrammes. Dans le cas du travail de Pol Pierart, c’est évidemment capital. Pierart choisira le super 8, non par nostalgie, mais bien pour l’aspect familier, voire même familial du médium, son caractère courant et sans prestige, ce grain de l’image très particulier. Les photographies sont toutes d’un même format, les films le seront aussi. Pierart choisit, la plupart du temps, des bobines de trois minutes. En amont, ces films sont écrit d’une façon très précises ; la post production est quasi inexistante. Elle se résume le plus souvent à l’adjonction d’une bande sonore, généralement décalée, aussi légère que le sujet sera grave. Souvent, le bruit mécanique du projecteur suffit à souligner le défilement des images. A ses films, Paul Pierart donne parfois un titre ; plus généralement, ils sont seulement numérotés. Le générique est dès lors minimal, d’autant que le scénariste, le réalisateur et l’acteur ne sont qu’une et même personne. Une seule complice prête son concours pour des scénarii en duo, aussi drôles et désopilants que graves. Pol Pierart renoue avec le cinéma muet ; ses écriteaux insérés dans l’image, comme dans ses photographies, feront office de cartons.
J’ai découvert les films de Pol Pierart lors de l’exposition ABC Art belge contemporain au Fresnoy à Tourcoing. On y projetait « Autoportrait ave ma ville » (2005). Il s’agit, du lever, (« je ne suis pas encore mort »), au coucher (« je ne suis pas encore mort »), d’une journée du cinéaste, déambulant dans Liège au gré des paysages urbains, des enseignes et inscriptions en tout genre qu’il repère et associe : Pol Pierart phrase ainsi l’espace urbain : « dans une ambiance de joie », « liquidation », « Bourgeois », « crise », « monstres », « donner sa vie », « tu dois collaborer » se succèdent au fil des plans. Pierart filme le bus qui descend de la banlieue, la ville, ses places, ses ruelles, ses friches urbaines. Deux cartons concluent la séquence: « il y a beaucoup de misère dans le monde », « et pourtant on ne peut être partout à la fois ». On repensera bien évidemment au détournement tel qu’envisagé par les Situationnistes, détournement profondément dialectique, tout comme à la « théorie de la dérive » telle que l’énonce Guy Debord : celle-ci se définit comme « une technique de passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de dérive est indissociablement lié à la reconnaissance d’effets de nature psychogéographique et à l’affirmation d’un comportement ludique – constructif, ce qui l’oppose en tous points aux notions classiques de voyage et de promenade ». Cette dimension situationniste plane sur toute l’œuvre de Pol Pierart, comme une attitude inscrite au cœur même du travail.
Trois films sont aujourd’hui à découvrir. Le premier cite et renoue avec l’esthétique des débuts du cinéma, de Feuillade en particulier. Son synopsis est simple : L’auteur, réalisateur et interprète se filme, marchant de dos dans un jardin. Un carton commente : « On part à la conquête de l’univers et on ne se connaît pas de dos ». Tandis qu’il a ainsi le dos tourné, une singulière Musidora, en bonnet et collants noirs s’introduit chez lui, fouille, dérobe un petit squelette en plastique qu’elle cache dans son giron, et est finalement surprise par le propriétaire des lieux. Querelle, l’homme lui arrache ce qu’elle considère déjà comme son bien ; l’œil mauvais, il secoue le petit squelette comme un prunier. « La mort est tellement dynamique, qu’elle doit bien avoir quelque chose de vivant ». Cependant, Musidora secoue, elle, un ours en peluche. Naître, donner la vie, vivre, mourir, autant de désespérances.
Le deuxième, cette fois en couleurs, est un diptyque, composé de deux bobines. La première est consacrée au malheur, la seconde au bonheur. Ce sont de muets instantanés, un film cousu de petites choses décousues. Défilent ainsi les images d’un couple assis sur un banc de jardin entouré de potirons et autres cucurbitacées, d’un pèse lettre posé devant un rideau flottant au gré du vent (il est vrai que Pol Pierart pèse chaque mot, chaque lettre), d’une promenade dans un chemin creux, près d’un ancien fort, d’une chute, celle littérale du caméraman. Un singulier cagoulard, présente à la caméra une série de cartons successifs. « J’ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise », lit-on. « Je commence par la bonne ». « Vous allez mourir ». « La mauvaise maintenant ». « Pas tout de suite ». Deux pieds masculins cachent le centre d’une inscription tracée sur le plancher, tandis que passent deux jambes féminines gainées de nylon. Le « désir » se lit sur le plancher. Les talons de la femme sortent du champ ; les espadrilles de l’homme disparaissent du côté opposé et dévoilent le mot « désunir ». Au mur, c’est « Etre et s’empêtre » qui se conjuguent. Mais, passons au bonheur : un travelling sur des haies tracées aux cordeaux sur des pavillons qui abritent autant de bonheurs conformes offre une belle transition ; les gazons sont entretenus, les pavés rigoureusement appareillés. « Ce sont des images comme on aimerait en voir tous les jours », lit-on sur un carton accroché aux buissons. Comme, peut-être, celles de ce vent d’été glissant dans un rideau de porte, celles de ces passants promeneurs entraperçus par la fenêtre, celle de cet homme qui repeint sa clôture. C’est « le bonheur pour tout le monde », insiste le scénariste. Une allée de verdure s’étire entre deux haies. « Ce qui nous manque, ce n’est pas de jouir. Mais de bander », lit-on sur deux cartons successifs. Quant aux nains de jardins, aux boîtes aux lettres les plus kitsch que piste enfin la caméra ; ce sont des « emerdveillements ». Plan final sur le même couple assis sur le même banc de jardin. Ils ont l’air préoccupés. Non, ils ont l’air de royalement s’emmerder. Finalement, je préfère les images du « malheur ».
Le troisième débute par un travelling sur un long carton manuscrit : on y lit « tête haute, profil bas ». Le ton est grave tandis que surgissent dans le prolongement du carton, l’image de deux tours jumelles. L’auteur réalisateur et toujours interprète a d’autres préoccupations. Dans l’atelier (A te lier), il déplace de gauche à droite et de droite à gauche de grands cartons dont l’encombrement est inversement proportionnel à l’étroitesse de la pièce. Leurs textes témoignent de nos ronchonnades journalières, cœur des lamentations quotidiennes : « c’est pas une vie », « trop c’est trop », « ras le bol de tout », « il pleut encore » (en fait, il neige), « vie de chien ». Chaque plan est entrecoupé de très courtes séquences de promenade en extérieur. Par la fenêtre, on voit défiler quelques voitures : elles évoquent les « heures de pointe ». Non, les « heurts de pointe ». Dernière sortie en extérieur, où l’on découvre un panneau d’interdiction frappé d’une tête de mort et du mot « Halte » que Pol Pierart a détourné en toute « Hâte » ou « hate », pour les anglophones. « Demain sera pire », carton final. Depuis l’image des tours jumelles, le fond sonore est léger et jazzy.
Assurément, à la vision de ces trois œuvrettes, comme les qualifie modestement Pol Pierart, « histoire de ne pas rire, l’expérience continue ».
1 Marcel Mariën est à l’origine des deux volumes de Nougé publiés en 1956 et 1967 (aux éditions Les lèvres nues, repris en 1980 et 1981 à l’Age d’Homme, coll. Cistre Lettres différentes) et intitulés respectivement Histoire de ne pas rire et L’expérience continue.
2 Pol Pierart, Angoisse ça te regarde ? Editions Yellow Now, 2013.
3 Philippe Dagen, « Pol Pierart, acrobate des doutes », dans Le Monde, 8 décembre 2002.
4 Paul Nougé, Notes sur la poésie, dans Les Lèvres Nues, n°3, octobre 1954.
5 Paul Nougé, Pour s’approcher de René Magritte, repris dans Histoire de ne pas rire, Les lèvres nues, Bruxelles, 1956
6 Geneviève Michel, Paul Nougé, la réécriture comme éthique de l’écriture, Université de Barcelone, 2006